Un film de Luc Besson, avec Mia Farrow et Freddie Highmore, France, 102 min.
Les membres de l’académie responsable de l’attribution des oscars ont jugé que le premier film d’animation de Luc Besson n’en est pas un. Le célèbre réalisateur du Cinquième Élément n’est pas froissé par cette décision. Après tout, l’histoire débute et se termine (pas tout à fait, le dernier plan est une image de synthèse) en prise de vue réelle. Seule la portion où notre héros Arthur se trouve miniaturisée se voit animée.
Le George Lucas français explique que cette approche avait pour but de montrer la différence entre le monde réel, le monde des humains, et le monde fantaisiste, le monde des Minimoys. Ce serait en comparant les deux mondes qu’on apprécierait totalement l’aspect fantastique du second. On ne peut toutefois passer sous silence l’aspect mercantile de la chose. En encadrant sa fiction animée de séquences tournées dans le vrai monde, avec des vrais acteurs (Freddie Highmore) et actrices (Mia Farrow), Luc Besson parvient à vendre un long métrage d’animation de une heure trente dans lequel il n’y a qu’une heure de dessins animés.
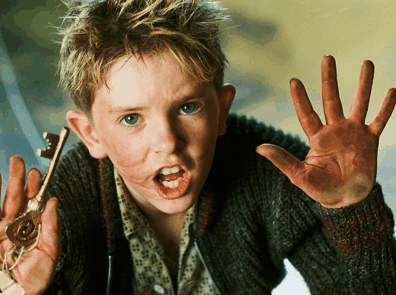
Cette étrange proposition d’un film hybride où une section animée se voit introduite et conclue par des séquences en prise de vue réelle n’a rien d’original. Winsor McKay employa cette technique en 1915 pour réaliser son Gertie le dinosaure, une oeuvre généralement reconnue comme le premier film d’animation. Plus récemment, James and the Giant Peach (Henry Selick, 1996) y allait de la même approche, cette fois à l’échelle d’un long métrage.
ATTENTION: le paragraphe suivant contient de nombreuses parenthèses…
Ce n’est pas le seul point où Arthur et les Minimoys manque d’originalité. Arthur et les Minimoys emprunte certains éléments de son intrigue au Seigneur des Anneaux (on ne doit pas prononcer le nom du méchant Maltazar, nos héros doivent se rendent dans son royaume maudit pour récupérer – plutôt que détruire – un trésor), aux Goonies (le jeune Arthur se lance dans une chasse au trésor pour sauver sa demeure familiale des créanciers) et, encore plus ouvertement, aux films des chevaliers de la Table Ronde (à la Excalibur). En plus de ses inspirations (que Besson ne reconnaît pas comme tel, il parle plutôt de clins d’oeil), le trio de protagonistes (jeune chevalier héroïque, jolie princesse, meilleur ami plus drôle qu’utile) s’avèrent aussi clichés que possibles.

On comprend Besson d’avoir joué la carte de la sécurité. Il avait déjà dépensé trente million d’euros avant qu’une seule image du film ne soit produite. Dans ces circonstances, vaut mieux appliquer une recette éprouvée. Mais au delà du manque d’originalité le film souffre aussi d’un manque de cohérence. D’une scène à l’autre, les proportions des objets par rapport à nos héros de deux millimètres de haut semblent erronées. Aussi, un des personnage possède un canif multi-fonctions qui, dans une scène, ne peut fournir de corde et, dans l’autre, oui. On dirait que les cinéastes se permettent ses excès en raison de l’intelligence peu développée de leur public cible. Mais à vrai dire, qui peut condamner un film pour l’irréalisme des proportions de ses personnages quand son intrigue purement fantaisiste explique comment une tribu africaine vivant au Connecticut miniaturise, à l’aide d’un télescope magique, l’un de ses membres pour communiquer avec une tribu d’êtres presque microscopique nommée les Minimoys?
Ce qui compte pour Besson (j’avoue lui prêter des intentions) c’est que les mômes se rendent au cinéma, voient le film, et veulent revenir pour la suite. Avec des scènes d’action plutôt entraînantes, des personnages assez jolis et sympathiques et des couleurs chatoyantes, nul doute qu’il remportera (comme Winsor McKay) son pari. Que le film ne soit pas très bon, ni très original, ni très mémorable importe peu, vraiment.